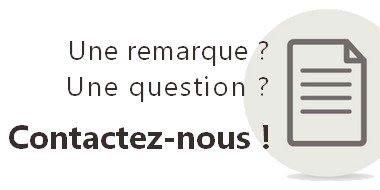La politique agricole du Burkina Faso
(Interview donnée au journal le Pays - le 18 juillet 2002)
www.lepays.bf
Voici l'interview de M. Salif Diallo, Ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques, donnée au journal "Le Pays".
"Le Pays" : Vous avez procédé le 12 juillet dernier au lancement du programme Sésame de la SOPROFA. Quel sens le ministère que vous dirigez donne-t-il à cet événement ?
Salif Diallo : Depuis l'année dernière, nous avons réfléchi à une nouvelle politique en matière de production agricole. Nous nous sommes dit que le blocage de notre agriculture est lié à l'absence de marché. C'est dans cette optique que SOPROFA a été créée pour lier notre agriculture au marché sous-régional et international. Notre ambition est donc de piloter la production agricole à partir de l'aval, c'est-à-dire à partir des opportunités qu'offre le marché. C'est ainsi que nous développons la politique des filières. Pour le sésame, les provinces du Bam, du Lorum et du Soum vont emblaver 10 000 ha. 20 000 autres ont été emblavés dans la boucle du Mouhoun, dans les Hauts bassins et dans le Sourou en sésame biologique.
Tout cela témoigne de l'engouement des travailleurs ruraux, de l'intérêt qu'ils ont pour le projet. Cette année, ce sont 17 milliards de F CFA que les paysans vont recevoir en contre-partie des achats. Pour nous, il faut également spécialiser les régions. Par exemple, la région de Titao (Lorum) a une pluviométrie très moyenne (600 - 650 mm). Elle n'est donc pas favorable à la culture du riz. Par contre, pour le sésame, le climat y est propice. Cette région pourrait devenir un pôle attractif pour la culture du sésame, notamment le S-42. Ainsi, les revenus des paysans vont passer du néant à plus dix, rien que dans les trois provinces. Pour cette année seulement, les producteurs recevront plus d'un milliard de F CFA dans la filière sésame. Nous pensons qu'avec ces revenus, ils vont acquérir des moyens de production plus élaborés que la daba et augmenter la production.
Il y a souvent un hiatus entre les objectifs du gouvernement et la réalité sur le terrain. Pour le "sésame bio", avez-vous pris des dispositions particulières ?
Avec la SOPROFA, il n'y a pas de hiatus. C'est du concret. L'année dernière, SOPROFA a injecté 12 milliards dans l'achat de produits agricoles et cette année, ce sont 17 milliards qui sont prévus pour être distribués en contre-partie d'achats. Aujourd'hui, il y a des zones rurales, des villages entiers que la SOPROFA a transformés en terme de revenus. Il y a des producteurs qui ont pu acquérir des charrues, des tracteurs. A Nouna, un seul groupement a reçu environ 261 millions F CFA l'année dernière. C'est dire qu'il y a quelque chose de substantiel. Comment procédons-nous ? Pendant la campagne, on identifie les groupements qui sont répertoriés. Chaque groupement est suivi par un encadreur. Cet encadreur est lié à la direction provinciale de l'agriculture. C'est toute une chaîne qui suit la production.
Les semences sont certifiées et les choix opérés en fonction de la demande du marché. Pour le sésame par exemple, nous sélectionons les variétés. Ces semences certifiées ont un rendement plus élevé que les semences classiques. Ensuite, nous dotons les producteurs d'intrants agricoles pour augmenter la productivité.
C'est dire que dans l'ensemble, les facteurs pour une agriculture moderne sont en train de se mettre en place à partir de la base.
Les difficultés observées dans certaines filières sont-elles dues au manque de maîtrise des acteurs ?
Effectivement. Je le disais lors de mon discours le 12 juillet. Il y a un manque terrible de professionnalisme. Nous avons des paysans pauvres qui étaient liés (et qui le sont toujours d'ailleurs) à une agriculture de subsistance. Pour les faire entrer de plain-pied dans une agriculture de marché, il y a un temps qu'il faut non seulement pour informer mais également pour susciter leurs intérêts. C'est en suscitant leurs intérêts qu'ils vont chercher à s'améliorer et devenir des professionnels dans leur filière.
Le programme sésame, le programme riz et le programme maïs, consacrent l'émergence d'agriculteurs modernes qui pensent au marché avant de produire.
Quel type de relation votre ministère entretient-il avec la SOPROFA ?
La SOPROFA est une société où l'Etat est actionnaire à hauteur de 25%. Notre optique, c'est de veiller, premièrement, à ce que les prix d'achat au producteur soient des prix justes, rémunérateurs et qu'on ne pille pas les paysans. Deuxièmement, il s'agit de l'encadrement. Que nos encadreurs puissent se mettre à l'école et de la production et de la commercialisation. Ce faisant, la SOPROFA travaille en étroite collaboration avec le ministère. Et, le choix des spéculations par région doit être agréé par les structures du ministère de l'Agriculture. La région de Titao a été choisie pour le sésame parce que les conditions agro-climatiques y sont favorables. D'ailleurs, nous envisageons cette spécialisation dans chaque région sur cette base.
Vous avez critiqué avec vigueur la mentalité d'assistanat développée au sein du monde rural. Quel défi y a-t-il à relever à ce niveau-là ?
Non seulement au niveau des producteurs, mais également au niveau de l'Etat même, il faut changer les choses. On ne peut pas continuer, avec le potentiel hydrique en eau de surface que nous avons, à savoir 9 milliards de m3, à quémander des vivres à chaque campagne agricole. Ce n'est pas honorable. Nous avons les moyens, aujourd'hui, de nourrir nos populations. C'est une question d'organisation du travail. C'est pour cela que nous insistons sur la production en saison sèche. Pour pallier le déficit de la campagne hivernale, nous allons entamer une seconde campagne en saison sèche à travers la petite irrigation villageoise. Là où il y a de l'eau, il faut que les gens puissent se lancer vigoureusement dans la production en saison sèche. Dans certaines régions, il y a de l'eau à fleur de sol et avec la pompe à pédale, déplaçable facilement, on peut irriguer 0,5 ha. L'expérience que nous avons menée avec le programme de la petite irrigation villageoise montre que le rendement est souvent meilleur qu'en hivernage, notamment pour le maïs.
Reste donc à vulgariser cette petite irrigation pour la généraliser...
Un atelier a été tenu sur la question . On y a relu les contraintes et ébauché les perspectives de ce programme. La phase pilote a été très satisfaisante et la question, aujourd'hui, est de formuler un vaste programme de sensibilisation. La petite irrigation, ce n'est pas un projet en tant que tel. Il s'agit de montrer l'utilité de la pompe à pédale, comment l'utiliser et surtout sensibiliser sur la nécessité de travailler 6 mois au lieu de 3 dans l'année. C'est ainsi que dans les différents projets qui existent au Burkina, nous allons travailler à ce que les paysans puissent utiliser cette possibilité.
Vous avez été reconduit ministre de l'Agriculture. Le département s'est même élargi à l'hydraulique et aux ressources halieutiques. Comment doit-on comprendre cette concentration ?
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ce ministère, peut-être liées à ma petite personne. En réalité, je tiens à dire d'abord que ce ministère n'a pas été créé pour Salif Diallo. Ce ministère a été créé pour les besoins de la cause. A savoir que le président du Faso, à travers le programme de développement solidaire et en fonction des étapes franchies ou à franchir, a vu la nécessité de remodéler la mouture gouvernementale. C'est un hasard qu'aujourd'hui je sois à la tête de ce département. Demain, ce sera quelqu'un d'autre.
Aujourd'hui, la problématique du Burkina Faso, "c'est l'eau pour quoi faire" ? Nous avons deux directions. La première c'est l'eau potable de boisson. La seconde, c'est l'eau pour l'agriculture. Si vous observez bien, nous sommes en train de passer de l'hydraulique villageoise à l'hydraulique de quartier. Cela veut dire qu'il y a eu des efforts substantiels en matière d'eau potable pour les populations.
Notre agriculture doit reposer sur la maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous détacher de la famine tant que nous resterons amarrés à l'agriculture pluviale. C'est pourquoi l'intégration du secteur eau à l'agriculture va de soi. Il n'y a que ceux qui sont de mauvaise foi ou ignorants qui peuvent contester la nécessité de reposer l'agriculture sur la maîtrise de l'eau. Ce sont là les raisons qui ont amené à la constitution de ce département.
Qu'en est-il des ressources halieutiques ?
Nous avons un potentiel d'environ 14 000 tonnes de poissons dans nos plans-d'eau. Mais seulement 5 à 6000 tonnes sont exploitées et commercialisées dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures. Or ce potentiel peut être multiplié par deux ou trois, si une politique effective et concrète de développement de la pisciculture et surtout une politique de commercialisation en aval des produits de la pêche est conduite. Donc, il faut réorganiser les acteurs, créer les circuits nécessaires qui vont reposer sur un travail d'ensemencement des plans-d'eau et d'équipements. C'est une faiblesse qu'il faut corriger, notamment celle liée aux équipements de conservation. Je pense que très bientôt , nous allons nous pencher sur ce dossier et imaginer réellement une politique halieutique efficace.
Vos partenaires , ce sont les populations du monde rural. Quel cadre de concertation existe-t-il entre eux et vous dans la mise en oeuvre des différentes politiques ?
Il y a une multitude d'organisations coopératives et pré-coopératives sur le terrain. Toutes ces structures sont liées aux structures étatiques dans les départements et dans les provinces et au niveau central. On peut compter sur les unions de producteurs, et les organisations faîtières qui ont des relations fonctionnelles avec nos structures. Bientôt, les chambres d'agriculture régionales seront mises en place. Ce sont des structures qui concourent non seulement à professionnaliser les acteurs, mais également à faire en sorte que les orientations essentielles de l'Etat soient reçues.
Aujourd'hui, le rôle de l'Etat, ce n'est pas de s'impliquer dans la production, mais d'en créer les conditions, d'orienter nos producteurs sur un travail utile. Et c'est dans ce sens que la politique des filières est mise en oeuvre.
Etes-vous satisfait de la structuration actuelle du monde paysan ?
Non. Il faut dire que c'est un processus qui n'est pas encore à son niveau optimal. Les groupements villageois sont au nombre de 15 à 16 000 et fonctionnent plus ou moins bien. Il y en a qui sont criblés de dettes et qui sont devenus des cas sociaux. Les chambres d'agriculture n'ont pas encore émergé. Les conditions juridiques et légales pour leur existence ont été créées, certes, mais nous attendons la fin de la saison des pluies pour travailler à leur mise en place.
Il faut dire que l'une de nos difficultés, c'est ce niveau général de connaissances de nos producteurs. Mais avec la deuxième phase du Programme national de gestion des terroirs (PNGT2), nous mettons en place des comités villageois de gestion des terroirs qui vont travailler à la base, pour éduquer, sensibiliser et amener les groupements à un niveau de conpréhension acceptable pour conduire leurs propres développements.
Il a été question, il y a quelques années, de l’insertion de nouveaux acteurs dans le monde agricole avec l’agro-business. Quel bilan faites-vous de ce processus ?
C’est nécessaire et incontournable que dans notre agriculture il y ait de nouveaux acteurs. Il faut créer les conditions pour l’émergence de ces nouveaux acteurs par l’accès aux crédits, au matériel de mécanisation et surtout par la sécurisation foncière. C’est par eux que viendra l'exemple.
On n'a jamais vu dans aucun pays, une agriculture émerger sans des professionnels, des gens qui viennent d’autres branches pour acquérir ou diffuser des connaissances et gagner leur vie.
Regardez les agents de la fonction publique qui sont soit à la retraite ou en fonction. Ils essayent de s’installer dans l’agriculture. La difficulté, par le passé, c'était le marché. Mais aujourd’hui, avec des structures comme la SOPROFA et bien d’autres, il y a possibilité de produire pour commercialiser. Les fonctionnaires qui se lancent dans cette activité ont beaucoup plus de revenus que ce que leur procure la fonction publique.
N’avez-vous pas peur qu’il y ait un conflit entre ces nouveaux acteurs et les autres ? De plus en plus, on parle d’une agriculture familiale qui préserverait entre autres l’identité des paysans.
Ça c’est du misérabilisme. Nous sommes dans un monde moderne de compétition. Tant qu’on va rester dans notre lopin de terre avec la daba, nous ne serons jamais compétitifs, et nous ne nous insérerons jamais dans le marché sous-régional et international. Il faut rester dans l’air du temps. Tout en respectant la démarche des producteurs familiaux, tout en les aidant à émerger, il faut également travailler à l’avènement de nouveaux acteurs qui vont avoir des superficies plus grandes, employer même des ouvriers agricoles. Nous sommes dans un monde de capitalistes. C’est quand notre agriculture emploiera peut-être 5 ou 15% de la population pour produire pour l’ensemble du pays que nous aurons réussi notre mutation.
Ces exploitations familiales dont on parle aujourd’hui, toutes regroupées, ne produisent pas plus que 2 ou 3 fermiers européens ou américains.
Le paysannat, c’est bien beau, mais il lui faut une autre dimension, celle de l’entreprenariat agricole pour aller de l’avant.
Que devient votre programme gomme arabique ?
Ecoutez ! Le programme gomme arabique, ce n’est pas mon programme . Il faut que les gens dépassent la personnalisation des projets. Quand j'étais au ministère de l’Environnement, j’ai initié ce programme auquel je crois beaucoup en terme de revenus pour les paysans qui s'y intéressent. La gomme arabique est demandée aujourd'hui sur le marché et des sociétés en demandent.
Notre difficulté, c'est la sensibilisation et la formation des producteurs. Il faut organiser la filière et effectivement à ce niveau, on fait du surplace depuis mon départ du ministère, je ne sais pour quelle raison. Un pays comme le Tchad exporte pour environ 10 à 13 milliards , le Niger entre 2 et 3 milliards F CFA. Les Nigériens viennent en acheter chez nous à Sebba et à Dori pour les commercialiser sur le marché sous leur label. Je pense qu'il faut une volonté politique tout simplement.
Dans votre approche du monde rural, vous semblez mettre l'accent sur la monétarisation. Dans notre contexte d'insécurité alimentaire, n'est-il pas plus pertinent de parler de disponibilité alimentaire ?
Vous faites bien de poser cette question. Un ingénieur européen disait qu'il y a la sécurité alimentaire quand le paysan lui-même achète sa farine de blé dans les magasins modernes.
Au Burkina Faso, on parlera également de sécurité alimentaire quand le paysan burkinabè ira au magasin du village pour acheter la farine qu'il aura lui-même vendu au meunier et que ce dernier aura mise en sachet. Concrètement, cela veut dire qu'il ne faut pas se faire des illusions.
Tant qu'il n'y a pas de marché, tant qu'il n'y a pas d'intérêt pécunier, les producteurs auront tendance à faire du surplace et à pratiquer une agriculture de subsistance. Donc, le marché est incitateur. C'est une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, nous utilisons le marché pour dépasser l'agriculture de subsistance, pour augmenter la production et éviter la famine.
Je prends un exemple. Dans le Sud-ouest, des paysans avaient aligné 5 greniers de maïs qu'ils n'arrivaient pas à écouler. L'année qui a suivi, ils ont réduit leur production de maïs. C'est tout à fait logique. Pourquoi produire plus si l'on ne peut pas vendre et conserver ?
En terme de marché, l'international est presque fermé à nos produits. Est-ce que le marché sous-régional offre des alternatives aux produits burkinabè?
Prenons d'abord le marché national. Il est important. L'exemple des céréales est là. Le handicap, c'était l'inorganisation des producteurs, le manque d'accès aux sites de production. Maintenant, on développe des pistes rurales pour fluidifier les échanges. Le marché national n'est pas saturé, loin s'en faut. Au plan sous-régional, le marché existe. Au plan international, le sésame est demandé. Pour certaines spéculations comme le karité, des opportunités existent également.
Mais, on ne comprend pas qu’après quarante ans, le Burkina en soit toujours à ce niveau avec une agriculture qui a du mal à émerger, un marché peu fluide.
Cette question, je vous la retourne aussi.
C’est vous qui pilotez les politiques de développement.
Nous avons eu de bonnes expériences. Il y en a eu de mauvaises également parce que nous n’avions pas de politique. Il faut faire la politique de sa géographie mais aussi la politique de son milieu. Tant qu’on était embarqué à suivre certains bailleurs, on ne pouvait pas s’en sortir. Je n’en dirai pas plus.
Vous êtes donc d’accord que parmi les projets que le Burkina a eus à exécuter jadis, certains ont échoué ?
Même pas jadis. Actuellement, il y a des projets à mon sens qui ne sont pas fiables au vu des intérêts de notre peuple. C’est pourquoi, nous-mêmes, au lieu d’attendre que l’on vienne nous donner des programmes et projets à grand bruit, il faudrait que nous ayons notre propre vision, des cadres dans lesquels les bailleurs de fonds viendront s’insérer. Il ne faut pas que quelqu’un vienne d’ailleurs pour nous fixer des objectifs à atteindre. C’est à nous de fixer nos objectifs et les partenaires nous accompagneront et non le contraire. Sinon, comment comprendre que quelqu’un vienne vous aider à développer une spéculation qui sera concurrente à celle qu’il développe chez lui ?
Vous semblez faire un reproche à l'OMC ?
Ce n'est pas à l'OMC en tant que tel, mais aux pays membres qui ont signé les accords qui interdisent les subventions à l'agriculture. Et qui en moins d'un an, se sont mis à subventionner à grande échelle leurs agriculteurs pour détruire nos filières. Aujourd'hui, le coton a des difficultés à cause des subventions américaines et grecques. Ces subventions sont illégales au regard des accords de l'OMC. On ne peut pas prôner la lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud, donner des financements pour les appuyer et détruire tout leur potentiel de travail. Aujourd'hui, le producteur américain de coton reçoit environ 2000 F CFA de subvention directe sur le kilogramme de coton. On ne peut pas être compétitif face à ces gens-là.
Vous parlez de compensations en retour, n'y a-t-il pas une autre alternative, sortir l'agriculture de l'OMC ?
L'agriculture est une industrie. Et si ceux du Nord ne subventionnent pas directement le producteur, ils vont le faire à travers les filatures. Le problème, c'est de laisser la libre compétition de toutes les filières sur le marché mondial. Le libéralisme économique, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont ceux du Nord et ils sont les premiers à le violer.
Avez-vous les moyens d'y faire face ?
Il faut s'organiser. Nous allons poser une plainte au niveau de l'OMC et les pays victimes vont exiger des compensations.
Abordons le programme Saaga qui a été officiellement lancé le 10 juillet dernier. Otez-nous d’un doute. La pluie du 11 juillet était-elle l’oeuvre du programme ?
Elle a été l’oeuvre de Dieu et du programme Saaga. Hier matin (11 juillet), on nous a signalé une perturbation qui venait du côté du Niger et qui devait se situer aux environs de 11 heures sur les hauteurs de Fada et de Zorgho. Et nous avons mis en oeuvre les ensemenceurs au sol pour densifier le volume pluviométrique. Et nous sommes donc satisfait de cette pluie.
Le vecteur aérien est désormais fonctionnel. Deuxièmement, les obus qui devaient arriver dimanche 14 juillet, sont en train d'être calibrés. Et nous pensons que très bientôt le vecteur aérien sera à l’oeuvre. L’importance du vecteur aérien, c’est qu’il est valable pour l’ensemble du territoire national aérien. Ainsi, il est possible de s’attaquer à des poches de sécheresse. Le vecteur au sol est limité et il ne concerne que le bassin du Nakambé.
Pourquoi ce bassin spécifiquement ?
Parce que la ville de Ouaga est alimentée par le barrage de Loumbila et les barrages de Ouaga. D’autre part, une partie de l’électricité que nous consommons provient des barrages de Bagré et de la Kompienga. Ces infrastructures commandent que les barrages soient remplis. C’est une nécessité parce que nous avons des difficultés en terme d’électricité et en terme d'eau de boisson. C’est ce qui explique le choix du bassin du Nakambé.
Mais l’objectif du programme Saaga, c’est d’installer des générateurs au sol dans toutes les régions agricoles. Cela se fera au fur et à mesure.
Le programme aurait coûté 4 milliards de F CFA. On peut savoir sur combien de temps ?
Non. Non. Les 4,5 milliards F CFA ont été utilisés de 1999 à 2001 pour payer les avions. Le radar a coûté 1,5 milliard. Les produits ne coûtent pas cher. C’est surtout les aéronefs.
Que répondez-vous aux sceptiques qui croient qu’au contraire le programme va chasser la pluie ?
Vous savez, dans chaque village, il y a des mesquins et nous, nous tenons fermement à ce programme. A son lancement, il a reçu la bénédiction de l’archevêque de Ouaga et du président de la communauté musulmane ainsi que celle des chefs coutumiers.
Entre ceux qui spéculent et la nécessité d’avoir la pluie, nous, nous choisissons la nécessité d’avoir la pluie par tous les moyens, qu’ils soient modernes, techniques ou que ce soit par les prières, etc.
A partir des expériences d’autres pays, nous savons que c'est un programme scientifique qui produit des résultats concrets. L'expérience marocaine nous a apporté un gain de 15% en quantité de pluie par rapport aux 10 dernières années et de 10% de plus par rapport au 37 dernières années.
Je vous le dis, s'il y a des nuages qui peuvent donner 10 mm de pluie, s'ils sont ensemencés, leurs rendements peuvent aller de 30 à 40 mm de pluie. Nous ne sommes pas le seul pays à ensemencer les nuages. Dans le monde, il y en a 36 autres.
Pour nous autres néophytes, n'y a-t-il pas de conséquences climatiques ?
Absolument rien !
Cette année, Ouagadougou a eu d'énormes problèmes pour la disponibilité de l'eau de boisson. N'y a-t-il pas lieu de revoir la gestion de l'eau pour la capitale ?
Non, la politique de l'eau pour la capitale est claire. Seulement, les infrastructures ne suivent pas. D'ici 3 ou 4 ans, le projet Ziga sera fonctionnel et nous aurons 200 millions de m3 pour Ouaga. Il y aura même un excédent jusqu'à l'horizon 2025.
Entre-temps, n'y a-t-il pas lieu de mettre en place des stratégies alternatives ?
Elles existent. Puisque nous avons fait des puits périphériques dont certains sont raccordés au réseau de l'ONEA (Office national de l'eau et de l'assainissement) avec des débits importants. Ce sont ces puits qui permettent de tenir le coup en période difficile.
Certaines voix proposent d'ouvrir le secteur de l'eau au privé notamment dans la création et la gestion des bornes-fontaines.
Oui. C'est même une des composantes de notre politique. Non seulement, il faut communaliser les bornes-fontaines mais également amener les opérateurs privés à prendre des concessions d'exploitation de l'eau. Et, il y a toute une série de mesures à prendre cependant pour ne pas offrir de l'eau impropre à la consommation. Nous prenons le temps de susciter l'intérêt du privé car c'est un secteur nouveau et beaucoup sont hésitants.
Est-ce à dire que la privatisation de l'ONEA n'est pas pour demain ?
Attention ! La privatisation de l'ONEA ne se pose pas en terme de demain ou après-demain . Le principe qui est retenu, c'est d'ouvrir le capital au privé. Ce n'est pas une privatisation totale. Il y a une loi qui la définit et le processus suit son cours.
Etes-vous un paysan dans l'âme ou plutôt un politique chargé d'une mission précise ?
Il ne faut pas se donner des vertus qu'on n'a pas. Dire que j'aime le monde paysan plus qu'un autre, je dis non. C'est beaucoup plus une question d'orientation, de vision et d'objectifs politiques à atteindre. On n'est pas forcément agriculteur pour être un bon ministre de l'Agriculture et vice-versa. Donc, c'est plus une question de conception, d'ouverture d'esprit et de capacité de travail.
Des indiscrétions au niveau de votre parti, le CDP, font savoir que vous seriez candidat au poste de chef du parti. Vous confirmez ?
Ce sont des rumeurs. Je ne suis candidat à rien. Et je pense que très honnêtement, il est bon que le camarade Roch Marc Christian Kaboré, président de l'Assemblée nationale puisse garder les commandes du parti c'est-à-dire le poste de Secrétaire national. Cela pour des questions de discipline au sein du parti et au sein des militants. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée et vous savez que notre majorité est relativement courte. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas de handicap à ce que Roch demeure le chef du parti. Maintenant le congrès décidera pour nous tous. Sinon je n'ai pas d'ambitions personnelles à ce niveau.
Merci de nous avoir reçus.
Je remercie le journal "Le Pays", pour cette occasion qu'il me donne pour parler de notre politique agricole. Seulement, je voudrais que les médias burkinabè s'intéressent davantage au monde rural. La plupart des quotidiens (c'est vrai que vous avez des moyens très limités) ne relatent pas beaucoup le travail de nos producteurs à la base, les initiatives louables des paysans dans les profondeurs du Burkina sont souvent ignorées. Mon souhait, c'est que la presse s'implique et aille voir ce qui est en train d'être fait dans le pays profond. Là aussi il y a des changements qui méritent d'être rapportés au public.