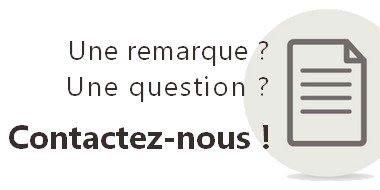|
Lutte contre la pauvreté : « Afrique en danger » |
|
Ce document est une réaction à un article paru dans le numéro 3170 du quotidien burkinabè "Le pays", daté du 19 juillet.
Il y a quelques temps, un ami du Niger me disait : « Cela fait vingt-cinq ans que nous luttons contre la pauvreté, et les gens, autour de nous, sont de plus en plus pauvres ». Il avait malheureusement raison, surtout si l’on considère les populations rurales du Niger et du Burkina Faso. Le rapport du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) sur le développement humain qui a été rendu public ce 15 juillet le confirme. Le Burkina y devance seulement le Niger et la Sierra Leone. A cette occasion, vous avez publié une contre analyse « Le Burkina figé » (page 2 du numéro 3170 du lundi 19 juillet 2004). Dans ce document, vous écrivez « Le Burkina souffre moins de manque d’argent que de refus de partager équitablement les fruits de cette croissance. » Vous poursuivez en ciblant une minorité qui s’enrichit par « la corruption, la fraude, les abus de biens sociaux, etc. » sur le dos d’une majorité de pauvres. On ne peut qu’être d’accord avec vous. Mais il me semble nécessaire de compléter cette analyse, par l’étude d’un autre phénomène : le déséquilibre croissant entre les zones rurales et urbaines. Dans le rapport de mars 2002 (page 27) « Les grandes orientations de la politique agricole de l’UEMOA », on peut lire : « La différence entre les revenus ruraux et urbains - qui est de 1 à 4 pour l'ensemble de l'UEMOA - atteint des proportions inquiétantes au Niger et au Burkina Faso. » En effet, il est de 1 à 7 au Niger, et de 1 à 9 au Burkina Faso. Il vaut la peine de s’attarder sur cette réalité. Dans les années 70, ayant demandé à un candidat à la députation à l’Assemblée Nationale, quel était le programme de son partis envers les paysans, j’ai reçu cette réponse : « Oh, les paysans ont ne les craint pas ! » Et de fait, tout se passe comme si la seule option politique claire des gouvernements successifs avait toujours été de privilégier les villes au détriment des campagnes. Peut-on espérer développer un pays composé d’une majorité de plus de 80 % d’agriculteurs et/ou éleveurs avec comme seul choix : nourrir la ville au moindre coût ? Comment s’étonner que les agriculteurs et les éleveurs s’enfoncent toujours plus dans la pauvreté, puisque aujourd’hui encore nous n’avons pas de véritable politique agricole ? J’ai cité le rapport « Les grandes orientations de la politique agricole de l’UEMOA. » Mais il faut savoir que cette politique agricole, en fait, n’existe pas ! Ou plutôt, elle n’existe que sur le papier ! Les difficultés que rencontres les négociations à l’O.M.C. (Organisation Mondiale du Commerce) peuvent nous aider à mieux comprendre la situation des pays de l’UEMOA. Les pays du Nord (qui, le plus souvent, n’ont que 3 à 5 % d’agriculteurs) se battent car ils veulent continuer à protéger leurs agricultures (soit par des taxes à l’importation, soit par diverses subventions). Or à l’UEMOA, sous la pression conjointe de la Banque Mondiale, du F.M.I. (Fonds Monétaire International) et de l’Union Européenne, les décisions ont été prises à l’envers. On a commencé par fixer le T.E.C. (Tarif Extérieur Commun), avant de réfléchir à une politique agricole ! Résultat, ce sont les pays les plus pauvres comme le Burkina et le Niger qui se protège le moins des effets pervers de la mondialisation. Alors que le Japon taxe le riz à l’importation à 490 % et le Nigeria à 100 %, le Burkina, par les règles de l’UEMOA, ne taxe le riz importé que de 10 %. Et l’aide alimentaire américaine (qui est gérée par le Ministre de l’agriculture des USA !) continue d’inonder les marchés de son riz (qui concurrence directement le riz local étuvé, privant un grand nombre de femmes de leur seul revenu). Conséquence : la misère s’installe dans les villages, spécialement dans les rizières pour lesquelles l’Etat burkinabè a investit des milliards de F CFA. Et les populations urbaines ne pensent plus qu’à consommer ce qui vient de l’extérieur. Signe évident de cet état de fait, les jeunes de la ville ne veulent plus manger le tô ou le sagabo. A tel point que de Bamako à Niamey, ces jeunes appellent le tô « Afrique en danger ». Et personne pour leur faire comprendre qu’ils se trompent complètement. C’est quand nous mangeons du riz thaïlandais ou américain que le Burkina et l’Afrique sont en danger. C’est quand nous mangeons des pâtes alimentaires faites avec du blé dur italien que le Burkina et l’Afrique sont en danger. C’est quand nous prenons un petit déjeuner composé de lait européen et de pain fait à partir de blé français ou allemand que le Burkina et l’Afrique sont en danger. Et nous pourrions continuer la liste : pourquoi consommer tant de confitures venues d’Europe alors que nous avons du sucre et des fruits qui pourrissent ? Pourquoi consommer tant de « Vache qui rit » importée quand la population du Burkina comprend 10 % d’éleveurs ? Pourquoi utiliser les cube Maggi ou Jumbo (dont l’effet sur la santé est pour le moins douteux), alors que le soumbala est parfaitement sain, et pourrait être développé de façon industrielle (en complétant, si besoin est, les fruits du néré avec du soja qui donne également un très bon sumbala) ? Revenons à votre article « Le Burkina figé ». Vous avez cité René Dumont. Mais vous avez oublié de donner son diagnostique : « L’Afrique noire est mal partie » à cause du mépris dans lequel elle a tenu et tient toujours ses paysans. Vous n’avez pas non plus mentionné son affirmation centrale. Pour se développer, pour sortir de la pauvreté, l’Afrique au Sud du Sahara doit offrir un prix rémunérateur au travail de ses paysans. Pour sortir de la pauvreté le Burkina et l’ensemble des pays de l’UEMOA doivent donner du travail à leurs paysans. Et pour cela, il est évidemment nécessaire de consommer les produits locaux. Quel avenir pour le Burkina, tant que sa population urbaine consommera les produits venus du Nord ? Aucun. D’où la nécessité pour les pays de l’UEMOA, déjà affirmée avec force par René Dumont et bien d’autres, de protéger leur agriculture. N’oublions pas que les agricultures des pays du Nord se sont développées derrière des barrières de protection. Et ils continuent à se protéger, notamment par leurs subventions aux agriculteurs. Les pays pauvres ne peuvent pas offrir les mêmes subventions à leurs producteurs. D’où la nécessité de faire reconnaître par la communauté internationale, le droit, pour tout pays, de se protéger des importations à bas prix par des taxes à l’importation. Et surtout ne croyons pas que le Burkina est incapable de se nourrir lui-même. En 2003, nous avons même obtenu un million de tonnes d’excédent de céréales ! Mais surtout, offrons un prix rémunérateur au travail des paysans, et la production de riz, de sésame, et de bien d’autres produits agricoles va doubler en deux ou trois ans. Cela est tout à fait possible, mais cela exige une réelle volonté politique. Pour faire émerger cette volonté-là, le pays a besoin d’un mouvement paysan fort qui fasse entendre sa voix, et ensuite d’une alliance entre les producteurs et une partie non négligeable des consommateurs urbains. Le jour où nous aurons retrouvé le goût et la volonté de consommer ce que nous produisons, le Burkina et l’Afrique ne serons plus en danger. Et les burkinabè pourront marcher la tête haute ! Koudougou, le 20 juillet 2004 |


- Pharmacopée traditionelle
- Spiruline
- 34) L'agriculture a le droit d'être protégée
- La souveraineté alimentaire selon le mouvement Via Campesina
- 2) De la rizière de Bama au marché de Bobo-Dioulasso
- Les outils d'édition en langue nationale du Burkina Faso
- A la découverte du monde rural au Burkina Faso
- Présentation du SEDELAN
- Liste des ABC au sujet de la souveraineté alimentaire
- Liste des ABC au sujet du riz en Afrique de l'Ouest